M... comme MALTRAITANCE
par
popularité : 15%
Sujet particulièrement sensible ! Central aussi puisqu’il conditionne, sans doute avant toute chose, l’acceptation par les familles d’une orientation en établissement : combien de refus de séjours de vacances, combien de refus d’un internat issus de cette peur - viscérale - de ce qu’il peut advenir ? C’est du reste de cette même peur que naît l’immense inquiétude des parents pour l’ « après eux » : tant que nous sommes en vie - peut-on espérer - nous pourrons protéger notre enfant... mais après ?
Fantasme ? Les faits, au long court, prouvent malheureusement que non. Celui ou celle qui, de par sa formation ou sa curiosité s’intéresse à l’histoire (parfois proche) a aussi de quoi nourrir un certain pessimisme.
Au-delà de ce constat, reste que la notion même est complexe et est donc susceptible de revêtir des configurations concrètes variées, et parfois peu « convenues ».
PREMIERE QUESTION : QUI MALTRAITE QUI ?
S’il semble entendu (! !) par la « vox populi » que le personnel des établissements, en internat et de nuit surtout, est potentiellement concerné, il me semble important d’y ajouter au moins trois types d’acteurs maltraitants :
- Les proches ( parents, fratrie.. ) le sont sans doute aussi fréquemment
- La personne handicapée peut l’être aussi envers son entourage, même si elle ne peut en être tenue pour responsable
- Indirectement, un employeur qui - confondant management industriel et « travail sur/avec de l’humain » - génèrerait des réactions professionnelles négatives serait concerné.
DEUXIEME QUESTION : COMMENT ?
- Maltraitance ? On pense sans peine aux coups, privations de sortie, de nourriture, mise à l’écart , insultes, voire aux agressions d’ordre sexuel... Inversement, a-t-on pensé assez au stress que génèrent des cris incontrôlables et surtout ininterprétables ? À l’impossibilité de dormir une nuit complète ? À ce sentiment d’impuissance, d’inutilité et de « vide » ? Cela, quelle famille, quel accompagnant ne l’a jamais éprouvé ? N’est-ce pas source de gestes que l’on regrette, de paroles trop vite prononcées ? A-t-on pensé à ces réunions où, sous couvert de « reconnaissance de la personne », chaque intervenant émet sur le résidant des points de vue difficiles à entendre et que les parents reçoivent, toujours, avec émotion ? Ne pas « comprendre » n’empêche pas de « ressentir » : le résidant peut en sortir bouleversé.
- Osons deux néologismes : « Trop-traitance » , « Non-traitance »...
« Non-traitance » : ne rien proposer, laisser dans son coin, peut être une tentation tant la prise en charge peut épuiser. Épuiser physiquement, moralement, mais aussi en termes de ressources. Ce peut être aussi le fait de ne plus « voir » la personne : année après année, on en a bâti une image, à tel point que l’on finit par s’étonner
lorsqu’elle se trouve contredite par les faits .
« Trop-traitance » : Le corps de la personne lourdement handicapée lui appartient-il ? La question n’est pas si saugrenue. Durant l’enfance, ce sont les « ortho » en tout genre qui se succèdent ; puis vient le temps des dysfonctionnements aggravés, qu’il faut bien tenter de pallier. Mais jusqu’à quel point ? De même, ne peut-on admettre - avec vigilance - un refus de boire, manger, se laver... s’il est ponctuel ?
- Quelles limites ? Laisser souillée la personne accueillie est communément, et à juste titre, admis comme anormal. Mais qu’en est-il de l’état des vêtements, des appareillages ? De l’état et de la préservation des affaires personnelles ? Certes, une sortie, une activité, peuvent être prioritaires : néanmoins, en-deçà d’un certain seuil de vigilance, la question mérite d’être posée. Si je considère le résidant comme un humain, à mon égal, vais-je vraiment négliger ce type d’attention ? Ma collègue met-elle indifféremment mes vêtements ou les siens ? Égare-telle mes affaires si elle a besoin de les changer de place ? Si je me salis au cours de mon travail, est-ce que je reste sale ? Quand mes enfants rentrent à la maison, quelle est ma réaction si... ?
Autres exemples : qui d’entre nous ne s’est jamais surpris à donner à manger à un rythme bien trop rapide ? Qui n’a jamais conclu que le repas était terminé - car déjà long - dès la première pause ? Qui n’a jamais décrété la nécessité d’un temps de repos sans consulter la personne concernée ? Les médicaments : tient-on assez compte de leur faculté à gâcher un repas ? De leurs effets secondaires ?
Enfin, quelle prise en considération des liens affectifs qui se nouent ou se révèlent improbables ? Que dire du déplaisir d’un résidant sans autonomie et sans choix d’être lavé, manipulé par quelqu’un avec qui il ne se sent pas en affinité (surtout si la réciproque est vraie) ? À contrario, que dire du chagrin au départ d’une personne aimée ? Certes, la vie de tout un chacun est faite de ces ruptures, de ces « deuils » successifs : encore faut-il qu’ils puissent être entendus. Évacuer cette source de vraie douleur potentielle d’un mot ( ah, le « professionnalisme » !) est un peu
rapide.
TROISIEME QUESTION : QUELLES REPONSES ? QUELLES NON-REPONSES ? POURQUOI ?
Deux remarques me paraissent au coeur de la question :
- Pour y remédier, encore faut-il pouvoir en parler. Tant que le sujet restera source de condamnation, il y aura des dérapages. Mais, parent ou accompagnant, comment s’exprimer ? Comment affronter les conséquences ?( signalement...). Et en même temps, il est absolument impossible d’exonérer la personne responsable de tout et n’importe quoi.
- Pour y remédier, encore faut-il ne pas être seul. Quand un parent s’énerve (ou un accompagnant), sa planche de salut réside dans l’autre, qui va s’interposer, temporiser, et surtout permettre de s’abstraire en prenant le relais. Quand on agit sous le regard d’autrui, on agit différemment. Quand on n’est pas seul, on peut parler d’autre chose, alléger la charge... se sentir malgré tout exister en tant qu’adulte « normal ».
- Il faudrait, dans les établissements, que les familles puissent se connaître et qu’elles soient associées à toutes les démarches de prévention. Demander - par enquête papier - aux familles si elles ont eu connaissance de problèmes de ce type est nul et non avenu.
- Pour y remédier, encore faut-il pouvoir vivre autrement, ailleurs, avoir le droit de s’absenter. À cet égard, la « chasse » à l’absentéisme - si elle ne peut être bien sûr totalement réprouvée - mérite sans doute réflexion. Comme mère d’une adulte polyhandicapée, je regrette que puisse manquer du personnel. Néanmoins, j’avoue aussi préférer une absence générée par une fatigue au travail - un « ras le bol », voire plus - à une présence contrainte et explosive.
Sans doute, du reste, serait-il intéressant , à terme et dans le cadre d’une démarche-qualité - de réfléchir à certaines méthodes de gestion des ressources humaines qui, prenant le contre-pied de pratiques classiques - veillent à offrir au salarié, sur le lieu de travail, certains avantages.
Ce ne sont là que quelques idées, sans doute banales, issues de mon expérience : mon souhait serait de les partager avec des interlocuteurs divers.
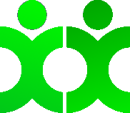


Commentaires